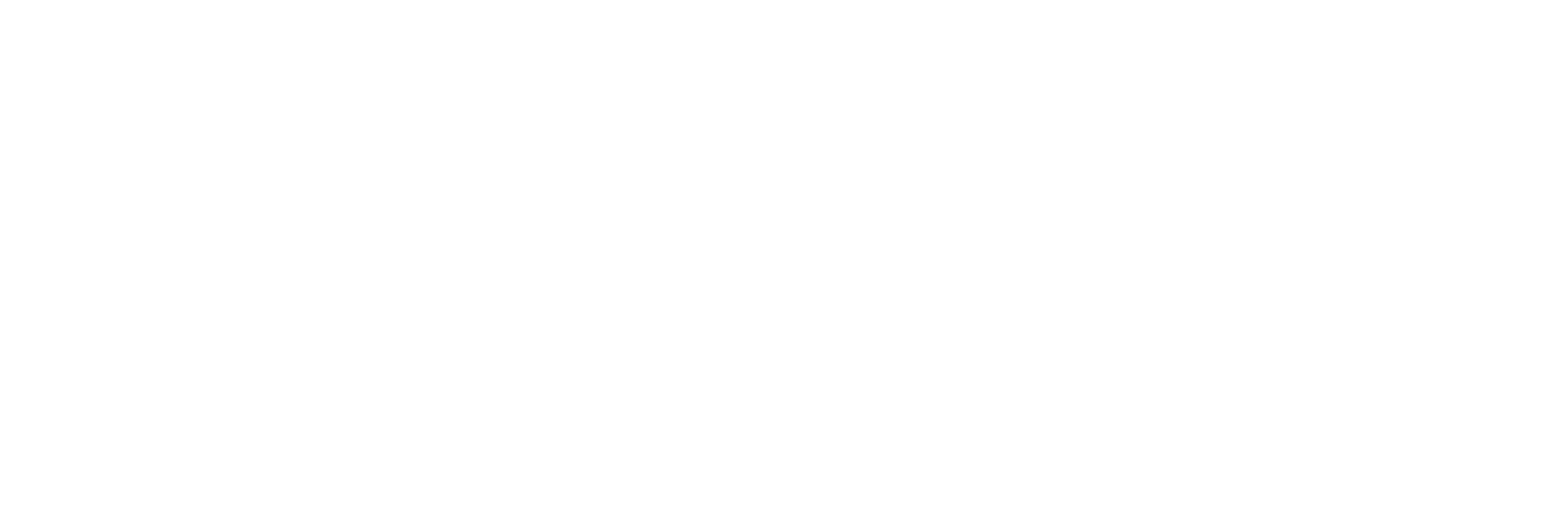Bienvenue à
Foyal
L’histoire de Fort-de-France
La construction du fort
La construction d’un fort bâti en palissades y débute, c’est le premier Fort Royal.
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les affrontements entre les colons et les Caraïbes, mais surtout avec les autres puissances coloniales – anglaise et hollandaise – en concurrence dans la région, renouvelle l’intérêt des Maîtres de la colonie sur la partie centrale de l’île, dénommée « Cul de Sac Royal ». Le site près duquel le Fort de Du Parquet est érigé est contrairement à celui du Fort Saint-Pierre marécageux et insalubre. Mais, dans le cadre de ma défense de l’île, la baie présente de gros avantages, le mouillage y est excellent et protégé.
Lorsqu’en 1672, commence la guerre entre la France et la Hollande, Monsieur de Baas administrateur de l’île insiste sur la nécessité de placer sur les points dominants de la Martinique des postes d’observation afin de prévenir l’arrivée des navires ennemis.
Pour parer aux attaques fréquentes de l’ennemi, notamment Hollandais, en 1672, Louis XIV ordonne la construction d’un Fort sur la pointe du cul-de-sac, « sur cette langue de terre qui s’avance dans la baie du Fort Royal », dira Sydney Daney qui en profite pour dire les avantages d’une ville sur l’autre :
« Le Fort Royal était une forteresse où l’on pouvait se défendre contre une attaque, et le Carénage un bastion où les navires étaient en sûreté, tandis que le Fort et la ville de Saint-Pierre étaient exposés de tous les côtés. »
La naissance de la Ville Fort-Royal
Ce n’est pourtant que l’année suivante, en 1673, après maintes tergiversations, que la décision est prise d’édifier une Ville aux alentours. Un plan établi, les colons peuvent obtenir des concessions dans l’espace à bâtir la Ville, sous le nom de Fort-Royal. La décision de créer une ville à proximité du Fort-Royal ne fait pourtant pas l’unanimité. Des voix s’élèvent pour s’opposer au développement d’une ville sur un terrain dont on dénonce le caractère marécageux, terrain dont l’air est malsain, générant le « mauvais air », la « malaria ». Les opposants privilégient Saint-Pierre où le terrain ne présente aucun de ces inconvénients.
En 1662 cependant, le gouverneur et lieutenant général des colonies françaises d’Amérique, Comte de Bléna, décide de faire du Cul-de-Sac Royal le chef-lieu de la colonie, scellant ainsi le destin de la Ville.
L'origine du drapeau
Il est temps de signaler l’origine du petit drapeau bleu aux quatre serpents que l’on voit, parfois, au fronton d’édifices publics du chef-lieu. Il a été crée par une ordonnance du 4 août 1766, et ainsi défini :
« Tous les propriétaires de vaisseaux, bâtiment, goélettes et bateaux dépendant du gouvernement de la Martinique et de Sainte-Lucie, feront pouvoir leurs bâtiment d’un pavillon bleu avec une croix qui partagera ledit pavillon en quatre : dans chaque carré bleu et au milieu du carré, il y aura la figure d’un serpent blanc ,de façon qu’il y aura quatre serpents en blanc dans ledit pavillon, qui sera reconnu dorénavant pour celui de la Martinique et de Sainte Lucie. »
Le Canal de la Levée
Assécher le sol de la ville est une préoccupation majeure. À cet effet, des axes de drainage sont créés. En 1763, débutent des travaux de construction d’un canal d’enceinte qui fait communiquer la rivière Levassor avec le Port, au droit de la Ravine Bouillé. Ce canal est creusé par une levée de terre, ce qui lui conférera le nom aussi, de « Canal de la Levée ». Il a vocation à recevoir les eaux des mornes qui cernent le site, et à assécher le site en contrebas. Notons qu’il est suffisamment large pour qu’y circulent, sur toute sa longueur, des canots à rames.
Fort-de-France doit faire face à des fléaux qui la mutilent. Le 11 janvier 1839, elle est dévastée par un tremblement de terre ; ce qui peut avoir incité à adopter un mode de construction générateur d’autres fléaux. Le 6 mai 1868, le bassin de raboub de Fort-de-France est inauguré, les travaux de construction ont duré près de dix ans.
Au XIXe siècle, Fort-de-France poursuit son développement, les foyalais sont de plus en plus nombreux dans le Centre, mais aussi dans les quartiers environnants qui commencent à se développer après 1848 et tout le long de la seconde moitié du siècle. La population du chef-lieu passe de 9 200 habitants à 16 056 habitants en 1894. Le canal d’enceinte pose à cette population des problèmes de salubrité de plus en plus importants. Le curage d’une partie du canal est ordonné, et vers 1857-1858 il est comblé et une route, la Levée est créée, elle marque la limite nord entre le centre-ville et le quartier des Terres-Sainville, aussi appelé le « quartier des misérables ».
La reconstruction
Le 22 juin 1890, la quasi-totalité du Centre de cette Ville qui compte alors, 16 000 habitants, est détruite par un incendie facilité par les matériaux de construction des maisons. Ce fut aggravé par un cyclone, le 18 août 1891, qui fit près 400 morts !
L’édilité doit relever un défi nouveau, et de taille: rien moins que de reconstruire la Ville. La vie reprend à foisonner, l’activité redémarre. Une nouvelle fois, les hommes réinvestissent la Ville.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Fort-de-France se positionne dans la vie économique, du fait, notamment, de nouvelles activités portuaires.
Les auteurs d’un petit opuscule diffusé par la colonie à l’Exposition Universelle de 1900 s’enorgueillissent :
Le port de Fort-de-France est l’un des plus vastes et des plus sûrs des Antilles. On y distingue le carénage où les navires se trouvent sous la protection du Fort Saint-Louis et la rade des Flamands. Il a rendu des services en 1778-1783, pendant les guerres d’Amérique, et en 1862-1867, durant la guerre du Mexique. Plus récemment, il a servi de point de ralliement aux débris de la flotte espagnole après la guerre de Cuba.
Mai 1902
Voici que la Martinique entre dans le XXe siècle, par la catastrophe du 8 mai 1902, qui est l’anéantissement de Saint-Pierre par la Montagne Pelée. Cela aura, jusqu’à aujourd’hui, des conséquences énormes sur la vie économique et culturelle de l’île. Fort-de-France, qui, de fait, est le centre principal d’accueil des sinistrés du Nord, et qui, parallèlement, hérite de l’activité commerciale et du négoce de Saint-Pierre, doit relever ce défi inattendu : assumer d’être l’unique grande Ville de l’île.
Seul grand centre urbain, Fort-de-France s’étend, gagne les hauteurs, crée de nouveaux quartiers, à desservir, et à aménager.
De 16 050 habitants au recensement de 1894, le dernier avant la catastrophe, Fort-de-France passe, à 52 051 en 1936, et à 66 000, en 1946. Le flux le plus dense semble avoir été apporté par la descente vers le chef-lieu des ouvriers agricoles et industriels, en conséquence de la déconfiture de l’économie cannière, à partir de 1960 environ.
Le site inhospitalier, cerné de marécages, menaçant de la malaria, dévasté par des fléaux aussi divers que tremblement de terre, incendie, cyclone, est désormais la Ville, la plus importante et la plus peuplée de la Martinique. Ville-Capitale, Fort de France polarise l’espace martiniquais, et doit répondre aux exigences tant des administrés résidents que des milliers de citoyens qui, quotidiennement, travaillent en son Centre, ou le traversent. C’est désormais un centre commercial, portuaire et administratif…
À propos
Au nombre des 135 quartiers que compte Fort de France, le centre-ville est le cœur historique en atteste des monuments séculaires, un patrimoine architectural et une activité marchande ancestrale.
Lieu de débarquement des navires marchands et de la production rurale, le quartier fut un lieu de tradition commerçante avec ses tonneliers, ses marchés, ses bars, ses magasins, ses taxi-pays, un lieu effervescent d’activités et longtemps un Eldorado « descendre en ville », Le rêve !
« L’envil » sous la plume l’écrivain martiniquais, dramaturge, biographe Patrick Chamoiseau, « Foyal » de la contraction de Fort Royal nom du fortin rocheux devenu le Fort Saint-Louis témoin de la naissance de la Cité Foyalaise, le centre-ville s’offre une nouvelle jeunesse avec Foyal Village / s’offre une nouvelle identité / identité de marque avec Foyal Village sur l’impulsion de l’Association Fort de France Cœur de Martinique.
Au pied des fortifications bordées par une petite plage, s’étale le centre-ville riche de près 1 000 boutiques et services dédiés au prêt-à-porter, à la mode, à la gourmandise et des spectacles, concerts toute l’année.
Tout un art de ville à vivre qui se mérite ! Quand Faut y aller, faut y aller, Soyons Foyalais !
Pourquoi Foyal Village ?
Une façon de raconter le centre-ville à travers les Femmes et les Hommes qui y font commerce et entretiennent dans une relation de proximité amicale, fraternelle avec leurs fidèles clients. Si vous cherchez une recommandation, on vous indiquera peut-être le nom d’une enseigne, mais souvent le prénom du patron. Un véritable petit « Village » fascinant où tout le monde se connait ou presque.
Séjourner à Fort-de-France

Hôtel Simon
1 avenue Loulou Boislaville – 97200 Fort-de-France
05 96 50 22 22

Fort Savane
5 Avenue de la Liberté
05 96 80 75 75

Hôtel L'Impératrice
15, rue de la Liberté – 97200 Fort-de-France
05 96 63 06 82

Le Patio foyalais
19 rue du Général Gallieni – 97200 Fort-de-France
05 96 39 09 09

Carib Hôtel
9, rue Redoute du Matouba – 97200 Fort-de-France
0596 60 19 85
Les grandes personnalités
Aimé Césaire
Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe et mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France,
est un écrivain et homme politique français, à la fois poète, dramaturge, essayiste et biographe.
Fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude avec Léopold Sédar Senghor,
anticolonialiste résolu, il mena en parallèle une carrière politique en tant que député de la Martinique
et maire de Fort-de-France durant cinquante-six années consécutives, de 1945 à 2001.
Pierre Aliker
Né le 9 février 1907 au Lamentin en Martinique et mort le 5 décembre 2013 à Fort-de-France à l’âge de 106 ans.
C’est un médecin et un homme politique français de Martinique, partisan de l’autonomie de son île.
Il est aussi cofondateur du Parti progressiste martiniquais.
Camille Darsières
De son vrai nom Camille Appoline-Darsières, né le 19 mai 1932 à Fort-de-France (Martinique)
et mort dans la même ville le 14 décembre 2006,
est un avocat et homme politique martiniquais, partisan de l’autonomie.
Il est député de la Martinique de 1993 à 2002.
Visiter les lieux culturels de
Fort-deFrance

La plage de la Fraçaise
Unique plage de la ville capitale et située au centre-ville, la plage de la Française finit la longue promenade du bord de mer (autrement appelée Malecon). Au pied du Fort st Louis, cette plage de sable blond est accessible en voiture, en bateau ou encore en bus.

Le Fort Saint-Louis (1640)
Ancien Fort Royal, puis Fort La République, il s’agit d’un ouvrage fortifié de type Vauban. Edifié à compter du milieu du XVIIe siècle dans sa limite sud-est de la ville basse, il constitue aujourd’hui la base navale de la marine militaire française aux Antilles et Guyane.

La Cathédrale Saint-Louis (1895)
Face à la place Monseigneur Roméro, la Cathédrale Saint-Louis se dresse au milieu d’une trame urbaine dense et colorée. L’édifice de 1895 est l’œuvre d’Henry Picq, architecte de génie qui signe à la même époque les plans de plusieurs autres bâtiments célèbres tels que la Bibliothèque Schoelcher ou le Grand Marché de Fort de France.

La Bibliothèque Schoelcher (1893)
Une des cartes postales traditionnelles de Fort-de-France ! C’est un bâtiment emblématique de l’architecture de Pierre-Henri Picq et visitable gratuitement en période d’ouverture. Ouverte sur la Savane, elle offre un bel angle de vue depuis le pont d’arrivée des croisiéristes et le futur arrêt de TCSP et créé ainsi un appel à la découverte de la ville. (Arrêt TCSP : Félix Eboué)

Le Malecon
Prolongement de la Savane, elle longe le fort Saint-Louis par une plage familiale : la Française. Puis une série d’espaces de jeux et de loisirs l’amène vers le kiosque Henri Guédon. Côté Ville, le long du front bâti, le boulevard Ernest Deproge propose ses bars, ses restaurants, ses terrasses… Entre la mer et le ciel, le Malecon est le lieu des promenades nocturnes, des grands événements sportifs et culturels, et des départs vers Trois-Ilets ou… la Caraïbe !

Le Musée d’histoire et d’ethnographie
Ancienne résidence militaire, cette maison bourgeoise témoigne de l’art de vivre à la fin du 19eme siècle à Fort-de-France. Une exposition permanente retraçant un intérieur créole avec ses objets et son mobilier vous y est proposée.

L’espace Muséal Aimé Césaire
Aimé Césaire, Homme de lettres et politicien martiniquais a travaillé dans ce bureau d’abord en tant que Maire puis Maire honoraire de la Ville de Fort de France. Inauguré le 26 juin 2013, date de son centième anniversaire, le bureau d’Aimé Césaire, vous accueille au 1er étage de l’ancien Hôtel de Ville.

La préfecture de la Martinique (1925)
Ancien palais du gouvernorat, il est d’architecture néoclassique.
Implanté à proximité de la Savane et de la Bibliothèque Schœlcher, il n’est pas ouvert au public.
(Arrêt TCSP : Félix Eboué)

L’Espace Camille Darsières (1907)
C’est l’ancien palais de justice et un des cœurs culturels de la ville.
Situé à proximité de Perrinon et de la rue piétonne, on peut y pénétrer par le square accueillant la statue de Victor Schœlcher
Partiellement ouvert au public, il accueille les ateliers du Sermac, une galerie d’art contemporain.

La Place Véronique Fabien
Donnant sur l’arrière du centre commercial Perrinon, cette place accueille régulièrement des animations comme la fête de la Musique. Elle est proche du Grand marché et non loin du parc culturel Aimé Césaire.